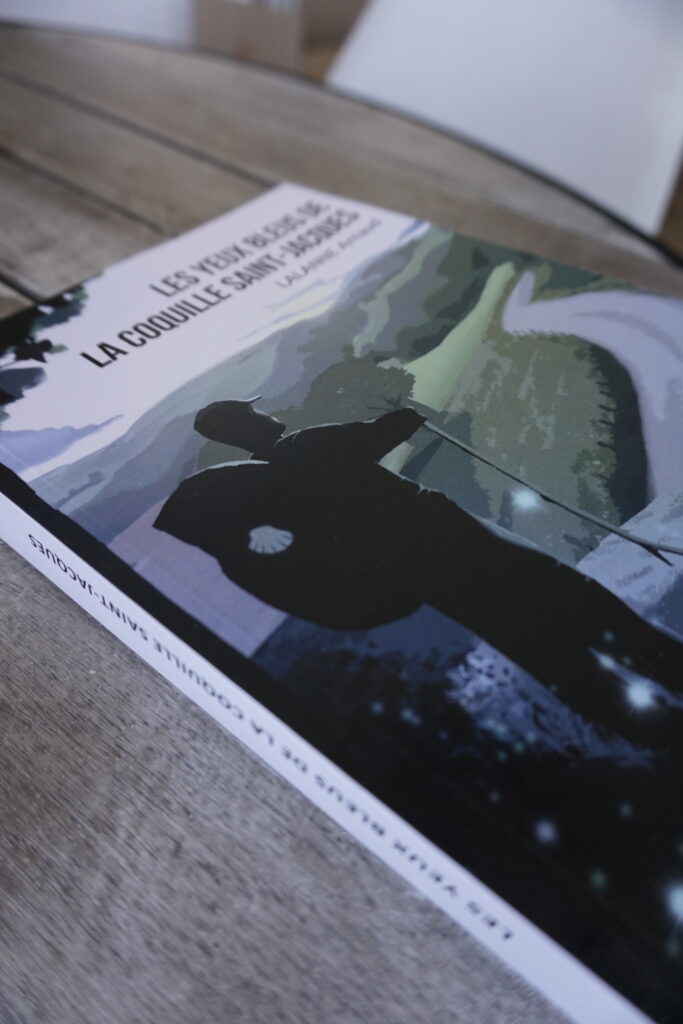À Taïwan, les aborigènes représentent une part précieuse, mais souvent méconnue, du patrimoine culturel de l’île. Ces peuples, présents bien avant l’arrivée des Han, forment seize tribus, chacune avec ses langues, ses pratiques et son histoire. Parmi elles, les Amis, l’une des plus importantes par sa population, se distinguent par des traditions enracinées dans la nature et le spirituel.
Avec environ 200 000 membres, la tribu des Amis est répartie en cinq groupes selon leurs territoires : des plaines côtières aux montagnes.
Curieux de mieux comprendre cette culture, j’ai eu l’occasion de rencontrer Paney Mulu, ethnomusicologue et prêtresse chamane. Figure incontournable de la tribu Amis, elle incarne à la fois la préservation des traditions et leur adaptation au monde moderne. Grâce à elle, j’ai découvert un univers où les chants prennent la forme de langage sacré et où chaque rituel honore la relation entre l’homme, la terre et les esprits.
Dès nos premiers échanges, Paney a souligné le rôle central de l’âme dans la culture Amis, où chaque élément de l’univers — les humains, les animaux, les plantes, et même les éléments naturels — est doté d’une âme. Pour expliquer cette croyance animiste, Paney a utilisé une métaphore simple, mais percutante.
« Imagine un poisson dans un aquarium, » m’a-t-elle dit. « L’eau de l’aquarium représente l’âme, et le poisson, le corps. Sans eau, le poisson ne peut survivre. Si l’eau diminue ou devient impure, le poisson souffre. Mais si l’eau est abondante et propre, le poisson s’épanouit. » Cette image illustre la vision des Amis : l’âme est ce qui nourrit et soutient l’être humain.

La tribu Amis et leur chant sacré
Chez les Amis, les chants traditionnels, loin d’être de simples divertissements, rythmaient autrefois tous les aspects de la vie. Les moissons, la pêche, les rites de passage — tout était accompagné de ces mélodies qui liaient les individus les uns aux autres, mais aussi à la nature qui les entourait. Les chants n’étaient pas qu’un moyen d’expression, ils étaient une nécessité. Ils invoquaient la protection des esprits, assuraient l’abondance des pêches et des récoltes, exprimaient la gratitude envers la nature et maintenaient l’équilibre spirituel.
Ce qui frappe dans les chants Amis, c’est leur caractère collectif. Pendant les cérémonies, les membres de la tribu se tiennent main dans la main, formant un cercle. Les chants s’élèvent, accompagnés de danses où chaque geste a un sens précis. Ce moment, partagé entre les vivants et les esprits, crée un espace sacré.
Parmi tous les chants Amis, « Ho Hai Yan » est sans doute le plus énigmatique. Ces trois syllabes, scandées en chœur, restent un mystère pour beaucoup de Taïwanais. Certains y entendent le son des vagues, d’autres un cri spirituel.
C’est là toute la complexité de « Ho Hai Yan ». Il n’y a pas de traduction littérale. Ces syllabes ne s’expliquent pas avec des mots. « Elles parlent à l’âme, pas à la logique », m’a expliqué Paney Mulu. Ce chant est un langage en soi. Selon la tonalité avec laquelle elles sont scandées, ces syllabes tracent des routes sonores différentes, guidant l’esprit dans une communion avec l’invisible.
En chantant ensemble et en dansant main dans la main, les aborigènes unissent leur esprit individuel pour former un esprit collectif et créer un espace sacré. Ainsi, il est primordial de chanter avec son âme pour que le son puisse se propager. Si vous n’y mettez pas votre cœur, cela ne fonctionne pas. Les participants doivent ressentir la connexion avec la terre et les ancêtres à la fois dans le chant et dans la danse. Cette connexion spirituelle crée un espace permettant aux esprits d’être avec eux.
Dans ce contexte, la chanson n’est pas juste un son pour les oreilles. Elle ne vient pas du corps, elle va du cœur aux lèvres, puis monte au ciel et redescend. C’est ainsi que les êtres humains se connectent avec le ciel et la terre.
Mais attention, dans la culture Amis, il est important d’être plusieurs pour effectuer ces chants, car si les esprits entendent une chanson et descendent alors qu’ils ne sont que deux, cela sera trompeur. Les esprits seraient mécontents et se vengeraient, causant des soucis aux personnes ou en les rendant malades.
En revanche, si le chant et la danse associée sont bien exécutés par la communauté, les esprits et les êtres humains seront connectés. Pour atteindre cette union, les anciens insistent sur le fait d’avoir un cœur calme. L’objectif n’est pas de chanter fort, mais avec retenue et respect. L’excès dilue la profondeur spirituelle. Il faut avant tout chanter pour sa propre âme, afin de se rendre heureux, puis partager ce son avec ceux qui sont autour. Un conseil digne d’un coach de The Voice !
Immersion au cœur d’une cérémonie chamanique Amis
Paney Mulu est l’une des huit chamanes, ou Sikawasay, de la tribu des Amis. Il y a dix ans, ils étaient encore une trentaine, hommes et femmes investis d’un rôle fondamental dans cette société matriarcale : guides spirituels, guérisseurs et médiateurs entre les vivants et les esprits. Leur influence dépasse largement les cérémonies rituelles. Ils représentent une mémoire collective, un lien vivant entre les individus, leur environnement et les forces invisibles qui les entourent.
Paney Mulu, à la fois ethnomusicologue et chamane, est à la croisée de la tradition et de la modernité. Tout en documentant les pratiques ancestrales pour les préserver, elle continue de guider sa communauté dans des rituels où chaque geste, chaque son, porte un sens profond.
J’ai eu la chance d’être invité par Paney à assister à une cérémonie dédiée aux récoltes. Ce moment fort avait pour but de remercier les esprits pour leur bienveillance et de purifier les participants. Les huit chamanes présents — sept femmes et un homme — étaient déjà rassemblés à mon arrivée. Les femmes portaient des robes noires ornées de motifs fleuris, avec des bandanas triangulaires rose pâle. L’homme, quant à lui, arborait un pantalon ample et une chemise florale rappelant les chemises hawaïennes, complétés par un bandana en longueur entourant son crâne.

La cérémonie s’est déroulée à proximité d’un petit sanctuaire taoïste, une structure modeste de deux mètres sur deux. Ce choix peut sembler surprenant au premier abord, mais il reflète la proximité culturelle entre les traditions aborigènes et la religion taoïste, plus largement pratiquée à Taïwan. Les chamanes Amis, qui n’ont pas de temples dédiés, privilégient avant tout les lieux imprégnés de spiritualité pour mener leurs rituels.
Sur une grande table à l’extérieur du sanctuaire, les villageois avaient disposé avec soin les offrandes rituelles : vin de riz, bétel, cigarettes, et gâteaux de riz gluant.
Dans les rituels Amis, l’alcool, central dans ces cérémonies, n’est pas là pour festoyer. Il est bien plus qu’un plaisir terrestre, c’est une immersion dans un état de conscience spirituelle qui ouvre la porte à une connexion entre les individus, leurs ancêtres et les esprits de la nature. Un seul grain de riz, après plusieurs rituels, peut devenir du vin, contenant les esprits du soleil, de la pluie, du travail acharné et de la famille. La consommation d’alcool transcende l’acte social pour devenir un acte de communion avec le divin. Boire du vin de riz ou de millet permet aussi de s’élever, de se libérer partiellement de son corps sans perdre le contrôle — une ivresse subtile, loin des excès. Attention, il s’agit là d’être dans la mesure pour se sentir allégé de son corps, sans en perdre le contrôle. En France, on appellerait ça : l’art subtil d’être pompette.

Six chamanes mènent la cérémonie, assistés par les deux autres. Pour démarrer la cérémonie, les chamanes remplissent leurs verres de vin de riz. D’abord, ils trempent leur doigt dans le liquide et projettent une goutte vers le ciel, comme une offrande aux esprits bienveillants. Ils répètent ensuite le geste, concentrés, pour renforcer la connexion avec le monde spirituel. Enfin, ils portent le vin à leurs lèvres.
Paney Mulu m’a précisé que ce rituel a pour objectif de synchroniser les esprits des participants et d’établir une harmonie collective. À travers ces gestes, les chamanes invitent les esprits à rejoindre l’espace sacré, tout en s’assurant que cette communion se fasse sous le signe de la bienveillance.
Une fois la connexion établie, les chamanes entonnent des chants polyphoniques, accompagnés de danses codifiées. Chaque chant, rigoureusement structuré, repose sur des répétitions et des silences calculés, créant un pont sonore entre les vivants et les esprits.
Pieds nus pour ressentir la terre, les chamanes accompagnent leurs chants de mouvements circulaires des bras, comme s’ils guidaient une force invisible. Au rythme des tintements des clochettes attachées à leurs chevilles, ils tapotent rapidement le sol avec leur pied droit. Ces gestes renforcent l’effet des chants pour tracer un chemin sacré reliant les esprits à la table des offrandes.Tout semble fluide, naturel, et à la fois puissant. Dans l’assemblée de villageois, pas un seul mot, tout le monde admire les chamanes.
Au fil de la cérémonie, l’intensité monte. Les chamanes, plongés dans une transe légère, effectuent des gestes plus spontanés. Dans l’assemblée, les femmes sont au premier rang, conformément aux traditions matriarcales. Les hommes interviennent brièvement pour recevoir une bénédiction : un tapotement sur le crâne avec une feuille de bétel, suivi d’une série de gestes destinés à purifier leur esprit.

Les directions cardinales jouent également un rôle crucial : à l’est, les premiers ancêtres de l’île ; au sud, les anges ; à l’ouest, les ancêtres récents ; et au nord, les esprits des artisanats. Chaque orientation correspond à une énergie distincte.
Au cours de la cérémonie, les chamanes ont orienté leurs chants et leurs danses vers l’est, puis vers le sud, afin d’inviter les premiers ancêtres et les anges à participer au festin. À chaque invocation, l’assemblée se déplaçait pour éviter de se trouver sur le chemin des esprits, au risque que l’un d’entre eux rentre dans notre corps.
Une fois les esprits rassemblés autour de la table des offrandes, les chamanes marquent une pause, pour leur permettre de profiter des mets disposés. Pendant ce temps, l’assemblée reprend ses discussions, créant une ambiance plus décontractée. Après environ une heure, l’une des chamanes se présente devant la table et lance des talismans au sol. La manière dont ils retombent détermine si les esprits sont satisfaits et prêts à repartir.
À la première tentative, les esprits répondent « non ». Il faut attendre une demi-heure avant qu’un second lancer indique qu’ils sont satisfaits.
Juste avant de renvoyer les esprits et les anges dans leur monde, les chamanes exécutent un dernier rituel. Deux d’entre eux, la plus jeune des femmes et le seul homme, s’avancent au milieu de l’assemblée, un bol de vin de riz à la main. Ils prennent une gorgée, gonflent leurs joues, puis soufflent l’alcool en une fine brume sur les participants. Ce geste a vocation à purifier chaque personne présente, en dissipant les mauvaises énergies qui pourraient encore les habiter. Tout le monde reste immobile pour recevoir les gouttelettes de ce spray d’alcool.

Les chamanes reprennent alors les chants et les danses pour raccompagner les esprits dans leur monde. La cérémonie devient de plus en plus intense, au point où deux chamanes en transe se mettent à pleurer en sanglots.
Une fois que les esprits sont repartis. Les hommes de l’assemblée brûlent de l’argent spirituel, des liasses de papier jaune doré avec un cadran rouge, pour les esprits des différents artisanats.
Enfin, tous les participants se sont rassemblés autour des chamanes pour partager les offrandes. Manger les offrandes, c’est nourrir notre âme de l’énergie spirituelle qu’elles contiennent.

Une culture en sursis
Les rituels chamaniques des Amis, bien qu’essentiels à leur identité, sont aujourd’hui en danger. « Il y a sept ans, une centaine de villageois participaient encore à ces cérémonies », m’a confié le chef du village. « Aujourd’hui, nous ne sommes plus qu’une quarantaine. » Ce déclin est d’autant plus alarmant que la relève tarde à venir : six des chamanes encore en activité ont dépassé les soixante ans. Si rien n’est fait, ces pratiques pourraient disparaître dans moins d’une décennie.
L’exode des jeunes générations vers les grandes villes est un facteur clé de cette érosion. Face à cette réalité, la tâche des Sikawasay, comme Paney Mulu, est immense : préserver un savoir oral vieux de plusieurs siècles et le transmettre à une communauté de plus en plus dispersée.
Pour lutter contre l’oubli, Paney Mulu s’est engagée dans un travail de documentation. Elle enregistre, archive et numérise les chants et récits traditionnels. Mais cette préservation matérielle ne suffit pas à maintenir vivante une culture qui repose avant tout sur l’expérience et le partage. « Les chants ne peuvent pas être réduits à des fichiers audio. Ils prennent leur sens quand ils sont vécus, chantés ensemble, avec les gestes et les émotions qui les accompagnent », explique-t-elle.
C’est pourquoi Paney va au-delà de la conservation. À travers des ateliers et des initiatives communautaires, elle invite les membres de la tribu, jeunes et anciens, à renouer avec ces pratiques. L’objectif est clair : faire en sorte que ces traditions ne deviennent pas de simples vestiges, mais qu’elles continuent à vivre et à évoluer, comme elles l’ont fait pendant des siècles.